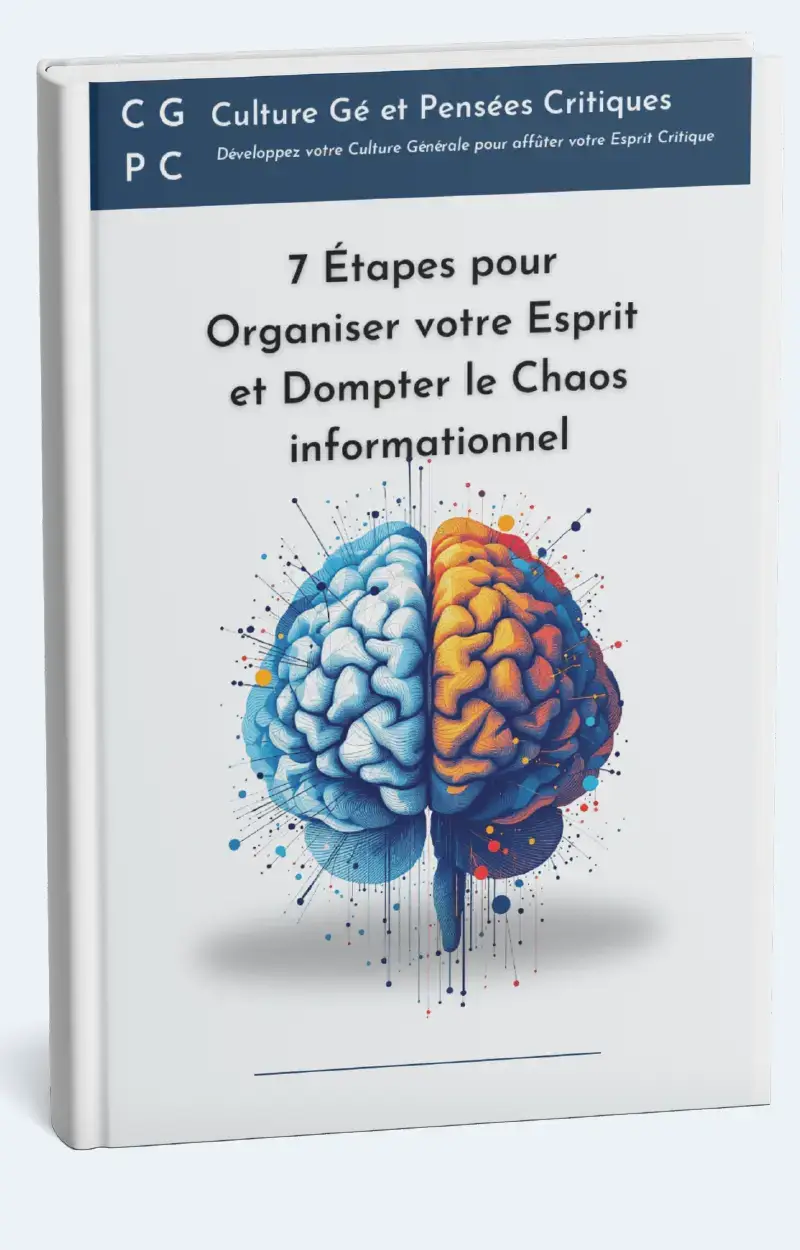Pourquoi personne ne se sent vraiment représenté aujourd’hui ?
Qui détient vraiment le pouvoir dans nos démocraties ?
C’est la question qui traverse en creux toutes les crises politiques contemporaines.
Ceux qui gouvernent sont-ils toujours légitimes aux yeux de ceux qu’ils représentent ?
Et quand la confiance disparaît, que reste-t-il du contrat démocratique ?
Après avoir étudié les fondements du contrat social chez Rousseau, Hobbes ou Locke, et les théories de la légitimité chez Rosanvallon ou Habermas, un nouveau chantier s’ouvre : comprendre comment le pouvoir s’exerce — et par qui.
Car au fond, parler de souveraineté, c’est toucher au nerf politique : qui décide, au nom de qui, et avec quel contrôle ?
Une bascule fondatrice : 1789, ou la loi comme expression de la volonté générale
Pour saisir l’enjeu, il faut revenir à un moment de rupture : 1789.
Les révolutionnaires français affirment alors un principe radical : la loi est l’expression de la volonté générale.
Pierre Rosanvallon le rappelle dans Le Bon Gouvernement : c’est une transformation majeure puisque dans la conception revolutionnaire, aucune institution ne saurait se mettre entre le citoyen et la loi.
La loi n’est plus la décision arbitraire d’un monarque, mais le produit d’une volonté collective — universelle et impersonnelle.
Le vrai pouvoir ne réside donc plus dans l’exécutif, mais dans la capacité à produire la norme.
De Jean Bodin à la démocratie contemporaine : la souveraineté c'est le pouvoir de décider
Le juriste Jean Bodin définissait, dès 1576, la souveraineté comme « la puissance absolue et perpétuelle d’une République ».
À son époque, cette puissance appartenait au roi. Mais depuis 1789, le souverain, c’est le peuple — ou, plus précisément, ses représentants.
Deux grands modèles en découlent :
- La souveraineté nationale repose sur la délégation du pouvoir à des représentants élus, garants de l’intérêt général.
- La souveraineté populaire considère que le peuple doit exercer lui-même son pouvoir, à travers des mécanismes de démocratie directe.
Ce ne sont pas de simples nuances sémantiques. Ces deux conceptions incarnent deux façons radicalement différentes de penser la démocratie — et structurent toujours nos institutions.
Un débat qui sévit depuis plus de 200 ans : défiance, participation, hybridation
Pourquoi cette tension revient-elle au cœur du débat public ?
Parce que nos régimes démocratiques vacillent entre deux impératifs contradictoires : le besoin de décisions stables, et l’exigence croissante de participation.
C’est précisément ce que souligne l’étude annuelle 2024 du Conseil d’État, entièrement consacrée à la souveraineté.
Le rapport affirme que la souveraineté n’est plus un bloc figé, mais un processus évolutif, redistribué, contesté.
Face à la fragmentation des territoires, à la montée des enjeux transnationaux (climat, numérique, migrations), et à la défiance généralisée, le Conseil d’État appelle à repenser la souveraineté comme un bien commun politique, à la fois partagé et renouvelable.
Autrement dit : comment créer des formes de souveraineté plus ouvertes, plus résilientes, plus justes ?
Dans un monde où la démocratie représentative est en crise, faut-il rendre le pouvoir au peuple, ou mieux encadrer ceux qui le détiennent ?
Comment articuler participation directe et délégation stable, sans tomber dans la démagogie ou la confiscation ?
Et surtout : quels dispositifs concrets peuvent réconcilier légitimité populaire et efficacité institutionnelle ?
I. Quand la confiance disparaît : la fracture entre le pouvoir et le peuple
Nous allons ici comparer deux modalités d’exercice du pouvoir : la souveraineté nationale (via les représentants) et la souveraineté populaire (via les citoyens). Notre méthode consiste à analyser leur fonctionnement, leurs effets concrets, puis à explorer s’il est possible de les articuler autrement, notamment via des dispositifs hybrides comme les conventions citoyennes.
1.1 La souveraineté populaire : l’exigence radicale d’un peuple législateur
Une souveraineté sans représentation : le principe rousseauiste radical
Chez Rousseau, le peuple doit voter directement les lois, car celles-ci incarnent la volonté générale.
« La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point. »
Concrètement, les textes sont soumis au peuple et seuls ceux qui recueillent l'assentiment, entre en vigueur. Le lien est direct entre le souverain et la production normative.
Une idée puissante, mais difficile à transposer à l’ère des États-nations
Comment, aujourd'hui, concilier l’idéal de gouvernement du peuple, avec les réalités des sociétés modernes ?
1.2 La souveraineté nationale : la fiction utile de la représentation
Une souveraineté exercée “au nom du peuple” : le principe représentatif en tension
L’article 3 de la Constitution française dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ».
Cette formule crée une ambiguïté : la souveraineté réside-t-elle dans le peuple concret ou dans la Nation, entité abstraite et indivisible ?
Le juriste Raymond Carré de Malberg y voit une fiction juridique nécessaire : les élus incarnent l’intérêt général. Il est distinct des volontés particulières.
Carré de Malberg : représenter l’intérêt général, ou l’inventer ?
Dans la pratique, les députés sont des représentants libres de voter selon leur conscience. Le processus législatif procède d'une logique de délibération qui doit permettre l'expression de la volonté générale.
Dans le même temps, la logique représentative prends acte de la complexification de la vie publique - le Projet de Loi de Finances fait plus de 1000 pages - et permet de créer une spécialisation parmi les représentants du peuple.
1.3 Deux modèles, deux impasses : entre instabilité populaire et confiscation nationale
Quand la souveraineté populaire se heurte à la complexité du réel
Les limites pratiques de la souveraineté populaire sont connues:
- Complexité technique : Gérer un budget ou une politique étrangère exige une expertise que le citoyen moyen ne possède pas, ce qui ne signifie pas qu’il ne peut pas l’acquérir.
- Instabilité potentielle : Les décisions populaires directes peuvent être influencées par des émotions ou des visions à court-terme (exemple : référendums sur l’immigration, peine de mort).
- Échelle des sociétés modernes : Rousseau imaginait des cités-États, non des nations de 67 millions d’habitants.
Une représentation stable… mais sourde aux transformations sociales
Si le modèle national permet une stabilité institutionnelle, il nourrit aussi une crise de légitimité :
- Les représentants peinent à incarner la diversité du peuple.
- Sentiment de manipulation des votes à des fins partisanes: le Gouvernement qui commende plus ou moins directement une large partie des textes examinés à l’Assemblée Nationale peut aussi être tenté d’organiser les travaux autour de textes qui ne présentent pas de risque majeur pour lui afin d’assurer sa pérennité au pouvoir.
- Déconnexion : Le Cevipof a fait une retranscription de 15 ans d'évolution de l'opinion publique. Il en resort que la défiance à l'égard des responsables politiques est d'une remarquable constance.

Il est tentant de croire que la souveraineté populaire garantit automatiquement la légitimité démocratique.
Pourtant, elle peut aussi conduire à des décisions conflictuelles, instables, voire dangereuses si elles sont prises sans éclairage critique. Inversement, la souveraineté nationale, bien qu’assurant la stabilité institutionnelle, peut générer un sentiment de dépossession politique.
C’est précisément cette tension qui rend nécessaire une réflexion plus fine sur la manière de combiner ces deux logiques.
À retenir
La souveraineté populaire repose sur une légitimité directe, mais bute sur l’échelle et la complexité des sociétés modernes.
La souveraineté nationale apporte stabilité et spécialisation, mais fragilise le sentiment d’inclusion démocratique.
❓Question pour le lecteur
Dans votre environnement (institution, association, entreprise), la répartition des rôles reflète-t-elle un modèle de décision plus “populaire” ou “national” ?
II Souveraineté nationale vs souveraineté populaire : deux forces en conflit
2.1 La délégation professionnalisée : stabilité ou dépossession ?
Le modèle de souveraineté nationale, théorisé par Carré de Malberg, repose donc sur une délégation professionnalisée du pouvoir.
Les représentants, ont les moyens (au moins matériels et financiers) de se familiariser avec les sujets complexes et assurent ainsi une continuité normative en adoptant des textes techniques (lois de finances, traités internationaux, etc...).
La professionnalisation de la représentation et le risque de déconnexion
Ce faisant cette logique rend possible des compromis entre partis et l'autonomisation des élus. Les représentants, non révocables pendant la durée de leur mandat, risquent de développer des intérêts propres, dans le cadre des nombreuses négociations auxquelles ils participent (discussion sur les textes, arrangements pour occuper des postes spécifiques dans les groupes parlementaires ou les commissions de l'Assemblée, etc...).
Deux approches contradictoires de la volonté générale : l'épisode du Traité de Lisbonne
La marge de manoeuvre qui est concédée aux représentant de la Nation pour assurer l'émergence de la volonté générale contre-productive, voire contradictoire avec l'expression du peuple.
L'exemple du Traité de Lisbonne en 2007 est un marqueur symbolique. Adopté par le Parlement après le rejet du référendum de 2005, il incarne une rupture entre la volonté populaire (le non l’a emporté avec 55% des suffrages exprimés) et décision institutionnelle.
Vers une dépossession politique ?
La principale limite du système représentatif est formalisée par Pierre Rosanvallon qui soulève le risque d'une dépossession politique - réelle ou ressentie -,poussant les citoyens à développer des contre-pouvoirs informels (manifestations, pétitions).
2.2 La démocratie directe : légitimité vivante ou piège procédural ?
Le principe fondateur : un pouvoir normatif exercé par le peuple
Le principe de la Souveraineté populaire repose sur l'exercice par le peuple de son pouvoir normatif.
Dans un ouvrage qu'elle a consacré à ce sujet, Geneviève Nootens défend l'idée d'une souveraineté exercée directement, via des mécanismes comme les conventions citoyennes ou les référendums.
La Suisse comme laboratoire : une souveraineté populaire en action continue
Le meilleur exemple de recours fréquent à la souveraineté populaire, est bien sur la Suisse:
Entre 1878 et aujourd’hui ce sont plus de 689 consultations qui ont été organisées. Cela représente 4 à 5 opérations annuelles sur des sujets techniques (taxes CO2, durée des congés parentaux).
L'intérêt de cet exemple est double:
- C'est la preuve qu'un peuple informé peut trancher des enjeux complexes.
- Ce modèle renforce la légitimité substantielle : 72 % des Suisses estiment que leur voix compte réellement
Quand la démocratie directe atteint ses limites : complexité, simplisme, instabilité
- La question de la complexité technique : Cet argument est traditionnellement présenté mais il ne pèse que peu: dans des nations qui se sont largement numérisées et pourront reourir au vote en ligne. Nous verrons ce point plus bas.
- Démagogie : Les campagnes référendaires simplifient excessivement les enjeux (ex. : Brexit 2016) ou les présentent sous un angle qui rend l’issue assez prévisible.
- Instabilité : En Californie, des analyses, comme celles du Public Policy Institute of California (PPIC), montrent que la superposition de réformes contradictoires, votées par référendum, a pu ralentir ou bloquer certaines évolutions du système éducatif.
À retenir
La souveraineté nationale permet des compromis durables, mais peut conduire à une confiscation du pouvoir par les élites.
La souveraineté populaire peut produire une légitimité substantielle forte, à condition d’un cadre clair et d’un apprentissage collectif.
❓Question pour le lecteur
Comment créer un espace de décision qui articule expertise, représentativité et volonté citoyenne sans sombrer dans l’illusion participative ?
III. Les effets concrets de cette tension sur nos démocraties
3.1 Défiance organisée : comment institutionnaliser le contrôle citoyen
Dans La Peur du peuple, Francis Dupuis-Déri analyse comment la souveraineté nationale – incarnée par des institutions représentatives comme le Parlement – fonctionne comme un mécanisme de filtrage social.
Selon l'auteur; l’agoraphobie politique, c'est à dire la peur du peuple assemblé (l’agora), pousse les élites à privilégier un système dans lequel le pouvoir est délégué à des représentants issus de milieux homogènes, plutôt qu’exercé directement par les citoyens.
Ce système permet de neutraliser les risques de démocratie directe, perçue comme imprévisible et dangereuse pour les intérêts des classes dominantes.
Dupuis-Déri montre que cette logique remonte à la Révolution française, où la représentation a été instituée pour canaliser les revendications populaires tout en préservant les privilèges des élites.
Représentation de l'Assemblée Nationale en 2024

Geneviève Nootens souligne que l’homogénéité socioprofessionnelle des élus (80 % issus de catégories supérieures en France) facilite les compromis techniques entre acteurs partageant codes et réseaux communs. Cette logique explique la stabilité du système représentatif, comme le montre l’adoption rapide de la réforme des retraites en 2023 malgré une opposition populaire massive.
Cependant, cette homogénéité génère une déconnexion croissante :
- Seuls 23 % des Français font confiance au président de la République et 24 % à l’Assemblée nationale (CEVIPOF, 2025).
- 58 % estiment que les élus « ne comprennent pas leurs préoccupations » (Baromètre Politique Ipsos, mars 2025).
Ce fossé transforme la souveraineté nationale en souveraineté de classe, illustrée par le décalage entre les priorités parlementaires (ex. : loi immigration 2024) et les attentes citoyennes (pouvoir d’achat, services publics).
Les formes d'expression populaire: entre exigence démocratique et limites pratiques
Les mécanismes participatifs sont soumis à une double exigence: d'un côté ils doivent être suffisamment complexes à mettre en oeuvre pour ne pas être mobilisés au gré des fluctuations médiatiques; de l'autre ils ne. doivent pas être rendus impossibles par des mécanismes trop complexes, au risque d'être seulement cosmétiques.
En France, leur existence semble être plus théorique que réelle :
- RIC inapplicable : Malgré les promesses post-Gilets jaunes, le référendum d’initiative citoyenne (RIC) n’existe toujours pas. Le seuil de 4,8 millions de signatures (10 % des électeurs) proposé en 2024 rend irréalisable toute forme d'intrusion dans le débat public.
- Convention climat 2020 : Seules 40 % des 149 propositions ont été intégralement appliquées, malgré une légitimité substantielle (150 citoyens tirés au sort).
- Référendum suisse vs français : Alors que la Suisse organise 4 à 5 consultations annuelles sur des sujets importants, (taxe CO2, congés parentaux), la France n’a organisé aucun référendum national depuis 2005.
3.2 Vers une démocratie réflexive : la contre-démocratie selon Rosanvallon
.Vous connaissez cet adage cher aux militaires: "La confiance n'empêche pas le contrôle". C'est exactement l'idée que nous allons développer ici.
Dépasser l’alternative classique
Pierre Rosanvallon propose une solution dans La Contre-Démocratie: l’institutionnalisation de la défiance populaire plutôt que sa diabolisation. Il identifie trois archétypes permettant d'envisager le rôle du citoyen dans l'élaboration et l'application de la loi.
- Le peuple-surveillant : il exerce sa vigilance via des pétitions ou des médias (ex. : affaire Fillon)
- Le peuple-veto : il doit pouvoir recourir au référendum révocatoire, comme en Californie où, depuis 1911, 55 tentatives ont abouti à la destitution de 2 gouverneurs.
- Le peuple-juge : pour fixer les grandes orientations sur des sujets fondamentaux de la vie en citoyenne. Le meilleur exemple réside dans les conventions citoyennes, comme la Convention climat 2020

Logique de la contre-démocratie
Cette approche combine l’efficacité représentative et un contrôle permanent : les citoyens ne se réduisent plus à un vote tous les 5 ans, mais exercent une pression via des « pratiques de surveillance, d’empêchement et de jugement »
On rejoint dans cette approche, l’idée de réflexivité qui est un des éléments présentés par Rosanvallon pour renforcer la légitimité démocratique.
3.3 Les dispositifs hybrides : trois outils pour réconcilier participation et efficacité
Nouveaux mécanismes participatifs
- Conventions citoyennes : 150 citoyens tirés au sort pour la Convention climat ont produit 149 propositions, dont 50 % reprises par la loi.
- Budgets participatifs : à Paris, comme au Canada, l’affectation d’une part des budgets d’investissement de la collectivité est décidée par les habitants8.
- Conférences de consensus : En mars 1999, le Danish Board of Technology a organisé une conférence de consensus sur les organismes génétiquement modifiés (OGM). Le panel de citoyens a reçu une formation préalable, puis a interrogé des experts lors des journées de conférence. À la fin, les citoyens ont rédigé un rapport de consensus qui résume leurs recommandations et leurs conclusions.
|
|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
| Accroître la légitimité de décisions complexes par une délibération élargie |
Technologies et démocratie électronique
Depuis 2005, l’Estonie est pionnière du vote en ligne : lors des élections législatives de mars 2023, plus de 51 % des suffrages ont été exprimés par internet, selon la Commission électorale estonienne. Cette expérience montre qu’un État peut organiser des élections nationales fiables et accessibles grâce à la technologie, tout en maintenant une participation élevée (63,7 % en 2023)
Transparence institutionnalisée
Au Canada, La Loi sur l’accès à l’information impose aux institutions fédérales la publication proactive de nombreuses informations, afin de garantir la reddition de comptes et d’accroître la confiance citoyenne dans les institutions publiques
À retenir
- Des dispositifs hybrides émergent pour combiner délégation et vigilance : conventions citoyennes, budgets participatifs, contre-démocratie.
- Le défi : éviter que la défiance légitime ne dégénère en “impolitique”, c’est-à-dire en paralysie collective du projet démocratique.
❓Question pour le lecteur
Quelle serait, selon toi, la bonne échelle pour déployer un mécanisme participatif utile, faisable et légitime dans ta propre sphère d’action ?
Conclusion
Souveraineté : ni dogme figé, ni formule magique
La souveraineté n’est pas une statue, mais un équilibre instable, un pacte vivant entre gouvernants et gouvernés. Elle ne tient pas toute seule. Elle se construit, se discute, se réinvente, à mesure que les sociétés deviennent plus complexes, plus fragmentées, plus exigeantes.
Opposer souveraineté nationale et souveraineté populaire revient à fétichiser deux extrêmes qui, dans les faits, ne se déploient jamais à l’état pur. Les modèles représentatifs reposent toujours sur une forme de délégation contrainte, mais ils ne peuvent plus ignorer la poussée participative. Les logiques directes renforcent la légitimité, mais doivent composer avec les impératifs de stabilité, de spécialisation et de clarté décisionnelle.
Le défi contemporain n’est pas de choisir, mais de combiner.
Nous devons penser des formes hybrides, des mécanismes qui intègrent le meilleur des deux souverainetés : la continuité et la réversibilité, la compétence et la vigilance, la procédure et le vécu. Cela suppose de passer d’une démocratie de la délégation à une démocratie de la co-construction.
Et ce défi dépasse largement la sphère politique.
Les mêmes tensions traversent les entreprises, les partis, les associations, les mouvements citoyens : qui décide ? comment ? dans quelle mesure peut-on déléguer sans se déposséder ? comment associer sans désorganiser ? Toute organisation confrontée à la complexité de la participation est, en réalité, face à un problème de souveraineté.
C’est la raison pour laquelle nous avons conçu une infographie transversale, applicable à tous ces contextes, pour aider à identifier les leviers de participation, les zones de blocage et les points d’équilibre.